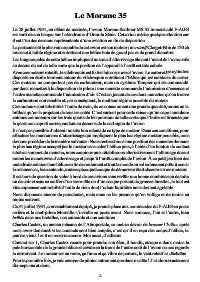Page 11 - C'est la Faute aux Oiseaux
P. 11
Le Morane 35
Le 28 juillet 1931, en début de matinée, l’avion Morane-Saulnier MS 35 immatriculé F-AIJG
est sorti de son hangar sur l’aérodrome d’Oran-la Sénia. Cet avion mérite quelque attention car
il est l’un des derniers représentants d’une aviation en fin de disparition.
La particularité la plus remarquable de cet avion est son moteur : un rotatif Clerget-Blin de 130 ch
tournant à faible régime et entraînant une hélice bois de grand pas et de grand diamètre.
Les longues pales de cette hélice impliquent un train d’atterrissage élevant l’avant de l’avion très
au dessus du sol de telle sorte que la position de l’appareil à l’arrêt est très cabrée.
Avec ces moteurs rotatifs, le vilebrequin est fixé et fait corps avec l’avion. Le carter et les cylindres
disposés en étoile tournent autour du vilebrequin entraînant l’hélice qui est solidaire du carter.
Ces moteurs ne comportent pas de carburateur, mais un système Tampier qui est commandé
par deux manettes à la disposition du pilote : une manette commande l’admission d’essence et
l’autre manette commande l’admission d’air. C’est en jouant de ces deux manettes qu’on trouve
la carburation convenable et, par conséquent, le meilleur régime possible du moteur.
Ces moteurs sont lubrifiés à l’huile de ricin, ils en consomment une grande quantité, moins en la
brûlant qu’en la projetant de tous les cotés. C’est surtout pour cette raison qu’un capot annulaire
entoure ces moteurs sur les trois quarts de leu pourtour de telle sorte que l’huile est évacuée par
le quart non capoté correspondant au dessous de la carlingue de l’avion.
Il n’est pas possible d’obtenir un très bon ralenti de ce type de moteur. Dans ces conditions, pour
effectuer les manœuvres d’atterrissage qui impliquent le plus bas régime moteur possible, nous
devions procéder de la manière suivante : Nous recherchions une position des manettes donnant
le plus bas régime accepté par le moteur sans caler l’hélice puis, à l’aide d’un bouton de contact
situé au sommet du manche, nous coupions puis rétablissons alternativement l’allumage durant
toutes les manœuvres d’atterrissage et jusqu’à l’arrêt complet de l’avion. À ce petit jeu bien des
maladroits calaient leur hélice en fin de roulement et tout le monde au sol se tenaient prêts à courir
la relancer car, bien entendu, toute espèce quelconque de démarreur était absente sur ces moteurs.
Il est hors de question de voler à bord de ces avions sans revêtir une bonne combinaison de toile
ou de cuir et sans se coiffer d’un serre-tête ou d’un casque portant de grosses lunettes, le tout est
vite copieusement imbibé d’huile de ricin dont l’odeur familière nous devient agréable.
Nous disposons encore de parachutes, mais nous ne les prenons qu’en voltige et de moins en
moins souvent.
Ce 31 juillet 1931, convenablement équipé, je prends place aux commandes du F-AIJG en poste
arrière et le chef-pilote Monville s’installe en poste avant. Nous sommes, l’un et l’autre, bien
brêlés dans nos bretelles, nos cuissards et nos ceintures.
Charles Castex, un ancien mécano de l’Aéropostale, se met en devoir de brasser l’hélice après
nous avoir demandé si les contacts sont bien coupés, c’est qu’il en reçu des coups d’hélice, le
pauvre vieux ! et il en recevra encore. Moi aussi, d’ailleurs.
Contact sur 1, Charles Castex recule pour prendre son élan, il bondit, attrape a deux mains la
pale horizontale de la grande hélice et cavale en la tirant de l’autre coté de l’avion ou nos regards
le retrouvent. Le moteur est en route, ça fume et ça vibre de partout, le vent relatif se déchaîne.
Pour la première fois, je vais essayer de piloter autrement que dans ma tête ! J’ai alors exactement
dix-sept ans et demi.
4 5